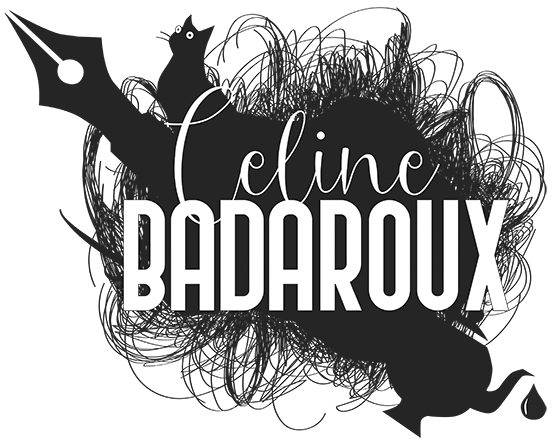A l’occasion d’Halloween, j’ai décidé de lire « Le vampire qui chante » de Jean Ray en live sur ma chaîne Youtube. Eeeeeeet… ça ne s’est pas du tout passé comme prévu.
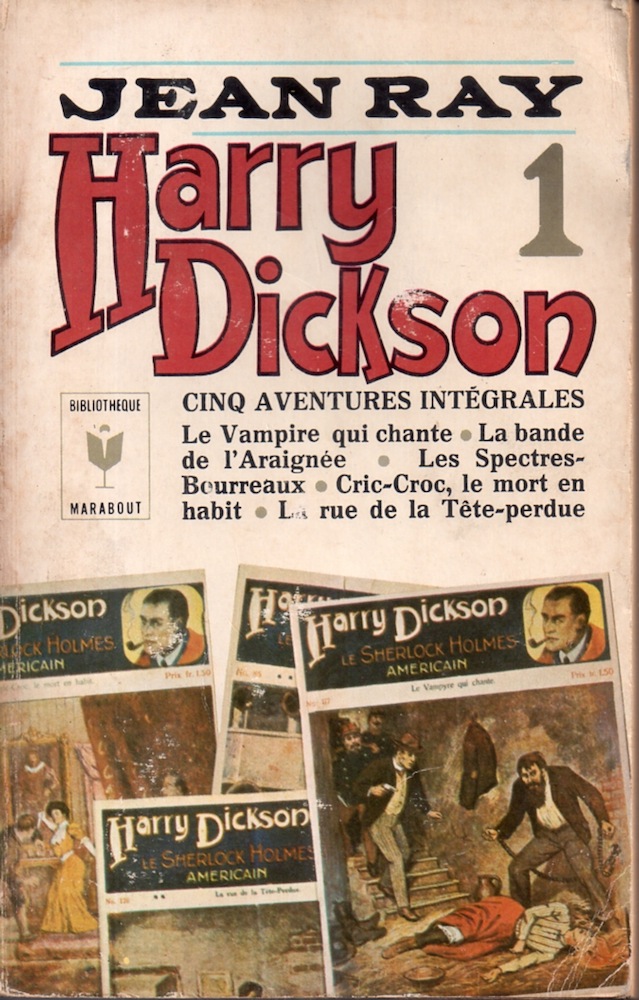
Si Jean Ray a un indéniable talent pour l’humour sociétal et les personnages désagréables, il surfe sans honte sur le succès de son inspiration (Sherlock Holmes) sans jamais se donner la peine de construire un personnage qui mérite sa réputation.
Il ne fait quasiment rien à part boire des bières, courir derrière un assassin, lancer son stagiaire sur des quêtes annexes qui (accessoirement) le mettent en danger pour à chaque fin de chapitre balancer un « ha ! ha ! J’ai trop comprendu ! » et… fondu au noir.

Il finira tout de même par élaborer un plan qui ne sera qu’un demi-succès, totalement indifférent à l’empilement de cadavres qu’il provoque, à l’exception d’une fois où il se sentira enfin coupable d’avoir provoqué le suicide d’un personnage. Mais laissez-moi ajouter qu’il s’en remet très vite alors que dans la même soirée il a déjà assisté à un suicide par balle en direct live. Zéro trauma, un chouia de regrets, mais bon voilà on va pas y passer la nuit, on a une truite saumonée qui attend à l’Hostellerie de la Tour. Accessoirement, laissez-moi vous dire que Jean n’a sans doute jamais vu de truite saumonée de sa vie, car il décrit « la chair blanche du poisson » comme un enfant des villes convaincu que le poisson nage déjà pané. Et je pense que ce serait donner trop de crédit à Jean que de dire « ouiiiiiii, mais tu compreeeeends c’est pour montrer que c’est un américain, tu vois ? Il se moque là en fait ». Non. A aucun moment, Harry Dickson (détective héros de cette aventure) n’est moqué. Et encore moins parce qu’il est américain. Il est présenté comme ce détective classieux, infaillible et puissant, dont les relations haut placées peuvent briser des carrières. Et en dehors de l’épisode du truite-gate, son goût est sûr et raffiné. Pas parce qu’on nous le montre, hein, détendez-vous. Mais parce que tous les personnages nous le disent.

Ah. Oui. Les personnages. Ou plutôt les victimes, dans cette histoire… sont toutes poussées à accepter la mort pour des raisons parfaitement insuffisantes que l’on devine aisément avant la fin. Peut-être que c’est davantage le signe d’un lectorat rôdé, nourri aux épisodes de Scooby-Doo et Miss Marple, et que le lecteur des années 50/60 était plus naïf, mais quelque part j’en doute. D’abord parce qu’à ce stade tout le monde connaît Sherlock Holmes, Rouletabille, et le chevalier Dupin. Hitchcock, Ian Fleming, Agatha Christie et Patricia Highsmith sont déjà dans la place dans les années 50 et le public n’est pas non plus né d’hier (c’est ma meilleure blague, notez la).

Et donc quand Demètre Ioakimidis écrit en parlant du recueil qui contient le « Vampire qui chante » : « C’est pourquoi ces récits peuvent être appréciés à plusieurs niveaux, et selon plusieurs angles. Il y a leur allure épique, leur indéniable poésie, leur écho de l’inconnu, leur rythme aventureux chacun de ces éléments représente à lui seul une raison suffisante pour suivre les traces de Harry Dickson. » (Fiction 162), non seulement je suis perdue, mais je me sens flouée.
L’épique en est absent, la poésie encore plus (vous n’aurez pas besoin de plusieurs lectures pour trouver les mots/expressions préférées de Jean qui reviennent aussi souvent qu’une lune gibbeuse chez Lovecraft), l’écho de l’inconnu quant à lui n’est pas présent très longtemps et le rythme aventureux se limite à voir courir ou grimper le détective quand il ne se cache pas dans le noir.
Même si l’on considère que ce n’est pas Dickson qui doit véhiculer les émotions mais son élève, le pauvre Tom Wills, ce dernier ne réussit qu’à passer pour un abruti qui ferait mieux d’aller faire de la poterie que d’essayer de devenir détective… ce qui n’est pas pour redorer le blason de Dickson qui a l’air de bien mal choisir ses stagiaires.

Bref. Si la mécanique de la révélation finale fonctionne chez beaucoup (et notamment chez Holmes), c’est parce qu’en cours de route le lecteur est happé par moults détails qui nous donne l’impression d’être nous-mêmes les détectives, de tenter de décrypter les émotions et les actions des personnages, mais ici rien ne semble suffisamment développé pour qu’on puisse se raccrocher à quoi que ce soit, le peu qui nous est donné est ficelé avec des cordages de bâteau difficiles à manquer… « Eh vous avez vu la façon dont ce personnage parle de tel autre ? » Wink, wink.
Mais ce qui m’a le plus manqué dans ce texte, c’est le mystère, la dimension fantastique, les créatures démoniaques. Parce que naïvement j’avais en tête que Jean Ray était ce qu’en disait Wikipédia, à savoir : « connu en français pour s’être largement consacré à la littérature fantastique ». Et… rien. RIEN. Pas la queue d’une chauve-souris (oui, j’ai vérifié, elles ont bien une queue), pas l’ombre d’un pieu, pas un miroir sans reflet. La DECEPTION. Est-ce que c’est ma faute ? Peut-être. Car j’ai eu le tort d’attendre de Jean Ray qu’il mélange Maupassant et Edgar Poe et que c’était sans doute trop demandé, surtout pour la fan inconditionnelle de Sherlock Holmes que je suis. Et sans doute là que la bât blesse, j’en attendais trop.
Pourtant, ça n’enlève pas à son texte ses défauts. Et je regrette que Demètre Ioakimidis n’ait pas mis en avant dans sa critique la seule chose que je retiens de ce texte : l’humour. Parce que j’ai ri. Plusieurs fois, même. Il a de bonnes répliques et une façon bien cynique de montrer ses personnages secondaires. Certes, il balance du sexisme à tout va, mais les personnages masculins en prennent pour leur grade aussi. On sent quelque part que Jean Ray prend un malin plaisir à se moquer de la plupart des gens, et la curiosité me pousse à me demander si c’est récurrent dans ce recueil… Mais c’est une question pour un autre jour.
PS : Si vous souhaitez lire ce texte, notez le TW psychophobie et utilisation de la maladie mentale comme une raison suffisante de tuer des gens, parce que bon il est fou, voyez.
Sources :